Mohamed Brahim Salhi : "Le Printemps 80 a contesté le particularisme ethno-religieux de la citoyenneté "
Page 1 sur 1
 Mohamed Brahim Salhi : "Le Printemps 80 a contesté le particularisme ethno-religieux de la citoyenneté "
Mohamed Brahim Salhi : "Le Printemps 80 a contesté le particularisme ethno-religieux de la citoyenneté "
Dans son essai "Algérie : citoyenneté et Identité" (éd. Achab, 2010), Mohamed Brahim Salhi invite le lecteur à une analyse méthodique de la construction de la citoyenneté en Algérie, de son émergence du mouvement national à nos jours.
Mohamed Brahim Salhi interroge les réalités de la citoyenneté, ses rapports complexes avec la modernité dans une approche socio-anthropologique qui, par l’analyse de ses facteurs historiques, ses pesanteurs sociales et politiques mais aussi ses revendications des mouvements de contestation, révèle dans toute son ampleur, une donnée idoine de l’identité d’un Etat moderne, hors de ses clichés et de ses usages galvaudés.
Si le mouvement national a construit un modèle bâti sur l’ethno-religieux dans le contexte colonial, ce particularisme a pourtant survécu à la guerre d’indépendance qui le justifiait en quelque sorte et révélé ses disfonctionnements, contradictions et dangerosité à l’orée de la décennie 80 et les années d’après. Le Printemps 1980, le mouvement citoyen des Aârch l’ont contesté par la revendication d’éléments que ce modèle niait : les libertés individuelles sur le plan de l’expression politique, la diversité linguistique, culturelles, cultuelles…
Cet essai se veut-il un éclairage scientifique du concept de "citoyenneté" et de ses réalités politique, sociale et culturelle dans l’Algérie du XXe siècle à nos jours, tant il a été, dites-vous, galvaudé ?
Mohamed Brahim Salhi : A partir des années 1990, ce terme est cité abondamment, chacun m’emploie comme il l’entend. Or, la citoyenneté est une construction politique et chaque société l’a construit dans son histoire où il prend sa signification. La citoyenneté est un lien entre les hommes, c’est une construction politique d’un pays. Elle est intimement liée à la notion d’appartenance ; appartenance à un pays. C’est pourquoi, j’ai introduit le vecteur de l’identité comme l’élément idoine de celle-ci. Le citoyen a un territoire, une langue, une histoire et la manifestation de la citoyenneté ne s’affirme pas d’un bloc. Selon les pays et leur histoire, en fonction de moments de crise, la citoyenneté observe parfois une forte émergence, parfois un net recule. En Algérie, cette construction se révèle surtout tout au long du 20 eme siècle.
Sur le couple "citoyenneté et modernité", vous écrivez que la colonisation n’a pas apporté la modernité et qu’au contraire, elle est "une version scandaleuse de la modernité". A l’origine, pourtant, la révolution française de 1789 est le berceau de la citoyenneté ?
Dans notre histoire, c’est à partir de l’émergence du mouvement national, dans toutes ses composantes, que les Algériens se sont accaparé de la modernité dont la colonisation prétend avoir le monopole et qu’elle est venue en quelque sorte imposer. En fait, la colonisation, ce n’est pas du tout la modernité. Par rapport au modèle original en France, ce qu’a donné la révolution de 1789, la colonisation est une version scandaleuse de la modernité. Pourquoi ? Dans la version originale, le fondement de la citoyenneté est la liberté de l’individu, le respect de sa langue, de ses croyances, de ses droits politiques ; il est égal à tous les autres individus qui vivent dans la même société. Or, la colonisation a été exactement le contraire de tout cela. Ainsi, les Algériens à travers le mouvement national, vont s’emparer des instruments de la modernité, notamment les partis politiques, les syndicats, et ils vont exprimer à ce moment-là une demande d’accès à la modernité : la liberté, l’égalité, la souveraineté. Ce concept de "colonisation positive" dit que c’est la colonisation qui a apporté la modernité. Au contraire, elle a empêché l’entrée en modernité des Algériens.
L’essai peut être lu comme une approche socio-anthropologique du concept de la citoyenneté : son émergence et sa forme dans le mouvement national, durant les deux décennies après l’indépendance, ses ruptures dans le Printemps berbère, le mouvement citoyen des "Aârch"…. Globalement, quelles en sont les éléments constitutifs de cette " révolution " de la citoyenneté ?
Le mouvement national, en lui-même, constitue une entrée en modernité, politique bien sûr. Dès lors, le citoyen tel qu’il se dessine dans ce mouvement national va s’exprimer à travers le modèle ethno-religieux. A cette époque, c’était une façon de se démarquer par rapport à l’autre. La mise en avant du couple "arabité – islamité" était là une façon pour le mouvement national de se démarquer, de poser une frontière identitaire nette avec notamment la population européenne. Mais le problème qui va se poser est que ce modèle va être conçu de façon un peu définitif, c'est-à-dire que cette composante ethno-religieuse ne tient pas compte de la diversité empirique de la société algérienne. De plus, ce modèle va être en quelque sorte antinomique à la citoyenneté tel qu’elle a été portée et promue par la révolution française de 1789 ou par d’autres modèles anglo-saxons que j’analyse dans le premier chapitre de mon essai.
Vous écrivez à ce propos : "L’idéal d’un Etat national et d’une Nation est inspiré d’un modèle jacobin, républicain, français. Mais, à la différence de ce dernier, la relation ethno-religieuse occupe une place centrale". Comment s’explique cette antinomie ?
Dans les faits, la construction de l’idée de l’Etat dans le mouvement national algérien va s’inspirer du modèle jacobin : un Etat unitaire, central, avec une seule langue. Mais, c’est l’aspect ethno-religieuse qui va intervenir dans cette construction qui, à l’origine, se fondait sur un Etat où l’individu est lié par un contrat politique avec les autres citoyens ; qui fonde le principe de la citoyenneté moderne. Ce type de modèle construit sur la dimension ethno-religieuse va s’imposer et se manifester jusqu’au début des années 80 et c’est justement avec le printemps 1980 que ce modèle a été contesté au profit des diversités, des libertés qui vont remodeler le modèle de la citoyenneté construit dans le mouvement national et qui a continué de fonctionner hors de son contexte colonial.
La fraternité s’oppose-t-elle à citoyenneté ?
La fraternité est un modèle qui institue une communauté dans laquelle l’individu n’a pas d’existence par lui-même. Il n’a de valeur qu’a travers les autres, la communauté religieuse, villageoise ou autre qui guide ses choix. En quelque sorte, sa liberté n’est pas respectée en tant que telle. Il n’existe que par rapport aux autres et au groupe.
Pour illustrer cette dichotomie, vous avez pris des exemples de termes usités dans les années 60 et 70 dans le discours politique officiel, notamment "frère et sœur". Pourquoi cet usage au lieu de "citoyennes, citoyens" ?
Dans la fraternité, il y a une relation de proximité. Entre frère, même s’il y a des oppositions, des différences, des conflits, tout cela est minimisé par la force de cette fraternité. Dans la fratrie, c’est la parole de l’ainé qui s’impose. La fraternité dans la religion procède de la même logique. Or, dans la réalité, la citoyenneté ne fonctionne pas à travers ces éléments subjectifs. Elle est bâtie sur la liberté individuelle du citoyen qui a ses convictions, qui pense librement car, en vérité, la citoyenneté promeut la différence. Or, dans nos sociétés, le lien essentiel est patriarcal, familial, généalogique et c’est ce modèle qui a été transféré dans le champ politique et il est devenu un outil de gestion dans la sphère politique. Le consensus qui est toujours recherché alors que dans la réalité les gens ne tendent pas forcément, tous, vers le consensus. La minorité n’est pas respectée . Le consensus noie les diversités quelles qu’elles soient.
C’est le Mouvement 80, soutenez-vous, qui a jeté les bases de la citoyenneté dans son acception moderne, hors du particularisme ethno-religieux…
C’est vrai. Que reste-t-il de la citoyenneté et du citoyen si sa langue, sa liberté sur le plan de son expression politique, ses convictions sont bafouées ? Or, la citoyenneté pleine signifie des droits civiques, politiques qui constituent ses fondements. Pourquoi le Mouvement 80 ? Il a montré que le modèle de citoyenneté tel qu’il est sorti du mouvement national n’a pas intégré ces fondements et en premier lieu, la langue. Quand vous dites à quelqu’un que sa langue dans son propre pays n’a pas de valeur, vous l’estropiez ; vous lui imposer des gardes fous à sa liberté, vous le mettez en cage, il ne peut pas s’exprimer comme il veut. Il n’y a donc pas de citoyenneté. Elle n’est que formalisme ; elle n’a pas d’existence réelle. C’est pourquoi, dans l’introduction de mon essai, j’ai souligné le fait que la citoyenneté n’est pas une vue de l’esprit. Ce sont des réalités. Avril 80 a révélé que la citoyenneté telle qu’elle a émergé dans le mouvement national et a continué de fonctionner avec le même modèle après l’indépendance, doit changer de construction ; tenir compte des diversités linguistiques et des libertés des individus. Pour ma part, le pense que le Mouvement 1980 a été un moment très important dans la reconstruction de l’approche de la citoyenneté dans notre pays.
Vous n’analysez pas le Mouvement 1980. Vous avez préféré donner la parole à deux acteurs du Printemps berbère dans un long entretien, sans aucun commentaire. Pourquoi le choix de cette forme journalistique ?
J’ai choisi la forme de l’entretien pour deux raisons. La première : ceux avec lesquels j’ai réalisé cet entretien sont des amis, des gens qui ont beaucoup milité pour la revendication berbère et les libertés. Pourtant, ils n’ont pas beaucoup parlé après ces années 1980. La seconde, 80, il m’a semblé que c’était mieux de restituer le Mouvement 80 à travers les acteurs pas à pas pour offrir un document à ceux qui veulent comprendre ce moment avec des données empiriques de terrain, sans théorie ni interprétation. Je ne voulais pas faire de commentaire, y introduire des analyses. C’est un témoignage brut. Il ya beaucoup de témoignages d’acteurs et c’est bien. Trente années après, chacun témoigne comment il a vécu cette période.
Vous avez comparé deux générations : celle du printemps 80 et celle du printemps noir de 2001. Quelles en sont les similitudes et les différences, sachant que vous avez relevé plus de différences que de similitudes entre elles ?
Entre 1980 et 2001, il y a un peu plus de 20 ans d’écart, mais, dans cette période relativement courte, la situation a changé. Les jeunes de 2001 ont grandi dans une autre situation économique, sociale, culturelle, politique… Donc, il est logique que le mouvement de 2001 ne soit pas la continuité ou la réplique de 1980. C’est la grande différence. Ils observent en revanche des similitudes. A un moment donné, la question linguistique, de l’identité est revenue. Les modes d’organisation, les mots d’ordre ne sont pas les mêmes. Mais le retour aux modes d’organisation des Aârch, Avril 80 n’a pas connu cela.
Y a-t-il une contradiction entre le terme de "Aârch" (et ce qu’il évoque en organisation tribale) et "le mouvement citoyen" qui s’en réclame ?
Bien sûr. Il y a une contradiction. Mais il faut se poser des questions : quelle est la valeur de ce mot en tant que réalité en 2001. Quelle était sa signification au 17e, 18e siècle ? Ce sont des questions essentielles. En 2001, il y a eu des expressions citoyennes quand les jeunes se sont exprimés contre la hogra. Mais comment est-on revenu à une organisation qui se réclame des Aârch, sans fondement à mon avis ? Je ne pense pas qu’en 2001, ceux qui se sont soulevés, ont protesté, s’inscrivent dans l’optique du Aârch au sens original du terme.
Vous écrivez : "Deux éléments m’ont aidé à trouver un fil conducteur des éléments d’analyse. Il s’agit d’abord de la mise en circulation du terme Aârch et de son usage massif par la presse et sa revendication par les acteurs de la contestation." Sa médiatisation en a-t-elle perverti le sens ?
Il y a eu une médiatisation qui m’a semblé un peu abusive du terme de Aârch , une singularisation à la fois du mouvement et de la région qui ne correspond pas à la réalité telle qu’on peut l’observer ou telle que le sociologue ou l’anthropologue peut l’analyser. La réalité est autre. Cet usage, ce mode d’organisation, je les ai observés personnellement. J’ai dit que sur le plan de la gestion de l’urgence, par exemple les comités de village, cela avait effectivement une existence mais l’organisation en terme de Aârch s’est surimposée et à mon avis, a été instrumentalisée.
A ce propos, vous avez employé une expression : "Le commandement collectif". N’a-t-elle pas une connotation péjorative ?
Non. Mais c’était un commandement collectif. Il y avait une instance qui s’était instituée comme commandement collectif de ce mouvement, de type "je ne veux voir qu’une seule tête". C’est la parole de ce commandement qui s’impose, impose ses décisions au détriment de toute autre voix divergente. La liberté des individus a été, à mon avis, limitée par ce mode d’organisation. Cela étant dit, il y a eu des comités de village qui avaient auparavant une existence réelle, comme intervenir, organiser, mais cela ne signifie pas un retour au 17e siècle. Certes, les citoyens ont utilisé le terme, mais je ne pense que, dans leur tête, ce soit un retour au tribalisme. La médiatisation officielle de ce terme a fait penser, effectivement, à ce retour au tribalisme…
Entretien réalisé par Rachid Mokhtari
Bio-express de l'auteur
Mohamed Brahim Salhi est docteur d’Etat es Lettres et Sciences humaines. Il est enseignant-chercheur en sociologie et anthropologie depuis 1979 à l’université de Tizi Ouzou.
Mohamed Brahim Salhi interroge les réalités de la citoyenneté, ses rapports complexes avec la modernité dans une approche socio-anthropologique qui, par l’analyse de ses facteurs historiques, ses pesanteurs sociales et politiques mais aussi ses revendications des mouvements de contestation, révèle dans toute son ampleur, une donnée idoine de l’identité d’un Etat moderne, hors de ses clichés et de ses usages galvaudés.
Si le mouvement national a construit un modèle bâti sur l’ethno-religieux dans le contexte colonial, ce particularisme a pourtant survécu à la guerre d’indépendance qui le justifiait en quelque sorte et révélé ses disfonctionnements, contradictions et dangerosité à l’orée de la décennie 80 et les années d’après. Le Printemps 1980, le mouvement citoyen des Aârch l’ont contesté par la revendication d’éléments que ce modèle niait : les libertés individuelles sur le plan de l’expression politique, la diversité linguistique, culturelles, cultuelles…
Cet essai se veut-il un éclairage scientifique du concept de "citoyenneté" et de ses réalités politique, sociale et culturelle dans l’Algérie du XXe siècle à nos jours, tant il a été, dites-vous, galvaudé ?
Mohamed Brahim Salhi : A partir des années 1990, ce terme est cité abondamment, chacun m’emploie comme il l’entend. Or, la citoyenneté est une construction politique et chaque société l’a construit dans son histoire où il prend sa signification. La citoyenneté est un lien entre les hommes, c’est une construction politique d’un pays. Elle est intimement liée à la notion d’appartenance ; appartenance à un pays. C’est pourquoi, j’ai introduit le vecteur de l’identité comme l’élément idoine de celle-ci. Le citoyen a un territoire, une langue, une histoire et la manifestation de la citoyenneté ne s’affirme pas d’un bloc. Selon les pays et leur histoire, en fonction de moments de crise, la citoyenneté observe parfois une forte émergence, parfois un net recule. En Algérie, cette construction se révèle surtout tout au long du 20 eme siècle.
Sur le couple "citoyenneté et modernité", vous écrivez que la colonisation n’a pas apporté la modernité et qu’au contraire, elle est "une version scandaleuse de la modernité". A l’origine, pourtant, la révolution française de 1789 est le berceau de la citoyenneté ?
Dans notre histoire, c’est à partir de l’émergence du mouvement national, dans toutes ses composantes, que les Algériens se sont accaparé de la modernité dont la colonisation prétend avoir le monopole et qu’elle est venue en quelque sorte imposer. En fait, la colonisation, ce n’est pas du tout la modernité. Par rapport au modèle original en France, ce qu’a donné la révolution de 1789, la colonisation est une version scandaleuse de la modernité. Pourquoi ? Dans la version originale, le fondement de la citoyenneté est la liberté de l’individu, le respect de sa langue, de ses croyances, de ses droits politiques ; il est égal à tous les autres individus qui vivent dans la même société. Or, la colonisation a été exactement le contraire de tout cela. Ainsi, les Algériens à travers le mouvement national, vont s’emparer des instruments de la modernité, notamment les partis politiques, les syndicats, et ils vont exprimer à ce moment-là une demande d’accès à la modernité : la liberté, l’égalité, la souveraineté. Ce concept de "colonisation positive" dit que c’est la colonisation qui a apporté la modernité. Au contraire, elle a empêché l’entrée en modernité des Algériens.
L’essai peut être lu comme une approche socio-anthropologique du concept de la citoyenneté : son émergence et sa forme dans le mouvement national, durant les deux décennies après l’indépendance, ses ruptures dans le Printemps berbère, le mouvement citoyen des "Aârch"…. Globalement, quelles en sont les éléments constitutifs de cette " révolution " de la citoyenneté ?
Le mouvement national, en lui-même, constitue une entrée en modernité, politique bien sûr. Dès lors, le citoyen tel qu’il se dessine dans ce mouvement national va s’exprimer à travers le modèle ethno-religieux. A cette époque, c’était une façon de se démarquer par rapport à l’autre. La mise en avant du couple "arabité – islamité" était là une façon pour le mouvement national de se démarquer, de poser une frontière identitaire nette avec notamment la population européenne. Mais le problème qui va se poser est que ce modèle va être conçu de façon un peu définitif, c'est-à-dire que cette composante ethno-religieuse ne tient pas compte de la diversité empirique de la société algérienne. De plus, ce modèle va être en quelque sorte antinomique à la citoyenneté tel qu’elle a été portée et promue par la révolution française de 1789 ou par d’autres modèles anglo-saxons que j’analyse dans le premier chapitre de mon essai.
Vous écrivez à ce propos : "L’idéal d’un Etat national et d’une Nation est inspiré d’un modèle jacobin, républicain, français. Mais, à la différence de ce dernier, la relation ethno-religieuse occupe une place centrale". Comment s’explique cette antinomie ?
Dans les faits, la construction de l’idée de l’Etat dans le mouvement national algérien va s’inspirer du modèle jacobin : un Etat unitaire, central, avec une seule langue. Mais, c’est l’aspect ethno-religieuse qui va intervenir dans cette construction qui, à l’origine, se fondait sur un Etat où l’individu est lié par un contrat politique avec les autres citoyens ; qui fonde le principe de la citoyenneté moderne. Ce type de modèle construit sur la dimension ethno-religieuse va s’imposer et se manifester jusqu’au début des années 80 et c’est justement avec le printemps 1980 que ce modèle a été contesté au profit des diversités, des libertés qui vont remodeler le modèle de la citoyenneté construit dans le mouvement national et qui a continué de fonctionner hors de son contexte colonial.
La fraternité s’oppose-t-elle à citoyenneté ?
La fraternité est un modèle qui institue une communauté dans laquelle l’individu n’a pas d’existence par lui-même. Il n’a de valeur qu’a travers les autres, la communauté religieuse, villageoise ou autre qui guide ses choix. En quelque sorte, sa liberté n’est pas respectée en tant que telle. Il n’existe que par rapport aux autres et au groupe.
Pour illustrer cette dichotomie, vous avez pris des exemples de termes usités dans les années 60 et 70 dans le discours politique officiel, notamment "frère et sœur". Pourquoi cet usage au lieu de "citoyennes, citoyens" ?
Dans la fraternité, il y a une relation de proximité. Entre frère, même s’il y a des oppositions, des différences, des conflits, tout cela est minimisé par la force de cette fraternité. Dans la fratrie, c’est la parole de l’ainé qui s’impose. La fraternité dans la religion procède de la même logique. Or, dans la réalité, la citoyenneté ne fonctionne pas à travers ces éléments subjectifs. Elle est bâtie sur la liberté individuelle du citoyen qui a ses convictions, qui pense librement car, en vérité, la citoyenneté promeut la différence. Or, dans nos sociétés, le lien essentiel est patriarcal, familial, généalogique et c’est ce modèle qui a été transféré dans le champ politique et il est devenu un outil de gestion dans la sphère politique. Le consensus qui est toujours recherché alors que dans la réalité les gens ne tendent pas forcément, tous, vers le consensus. La minorité n’est pas respectée . Le consensus noie les diversités quelles qu’elles soient.
C’est le Mouvement 80, soutenez-vous, qui a jeté les bases de la citoyenneté dans son acception moderne, hors du particularisme ethno-religieux…
C’est vrai. Que reste-t-il de la citoyenneté et du citoyen si sa langue, sa liberté sur le plan de son expression politique, ses convictions sont bafouées ? Or, la citoyenneté pleine signifie des droits civiques, politiques qui constituent ses fondements. Pourquoi le Mouvement 80 ? Il a montré que le modèle de citoyenneté tel qu’il est sorti du mouvement national n’a pas intégré ces fondements et en premier lieu, la langue. Quand vous dites à quelqu’un que sa langue dans son propre pays n’a pas de valeur, vous l’estropiez ; vous lui imposer des gardes fous à sa liberté, vous le mettez en cage, il ne peut pas s’exprimer comme il veut. Il n’y a donc pas de citoyenneté. Elle n’est que formalisme ; elle n’a pas d’existence réelle. C’est pourquoi, dans l’introduction de mon essai, j’ai souligné le fait que la citoyenneté n’est pas une vue de l’esprit. Ce sont des réalités. Avril 80 a révélé que la citoyenneté telle qu’elle a émergé dans le mouvement national et a continué de fonctionner avec le même modèle après l’indépendance, doit changer de construction ; tenir compte des diversités linguistiques et des libertés des individus. Pour ma part, le pense que le Mouvement 1980 a été un moment très important dans la reconstruction de l’approche de la citoyenneté dans notre pays.
Vous n’analysez pas le Mouvement 1980. Vous avez préféré donner la parole à deux acteurs du Printemps berbère dans un long entretien, sans aucun commentaire. Pourquoi le choix de cette forme journalistique ?
J’ai choisi la forme de l’entretien pour deux raisons. La première : ceux avec lesquels j’ai réalisé cet entretien sont des amis, des gens qui ont beaucoup milité pour la revendication berbère et les libertés. Pourtant, ils n’ont pas beaucoup parlé après ces années 1980. La seconde, 80, il m’a semblé que c’était mieux de restituer le Mouvement 80 à travers les acteurs pas à pas pour offrir un document à ceux qui veulent comprendre ce moment avec des données empiriques de terrain, sans théorie ni interprétation. Je ne voulais pas faire de commentaire, y introduire des analyses. C’est un témoignage brut. Il ya beaucoup de témoignages d’acteurs et c’est bien. Trente années après, chacun témoigne comment il a vécu cette période.
Vous avez comparé deux générations : celle du printemps 80 et celle du printemps noir de 2001. Quelles en sont les similitudes et les différences, sachant que vous avez relevé plus de différences que de similitudes entre elles ?
Entre 1980 et 2001, il y a un peu plus de 20 ans d’écart, mais, dans cette période relativement courte, la situation a changé. Les jeunes de 2001 ont grandi dans une autre situation économique, sociale, culturelle, politique… Donc, il est logique que le mouvement de 2001 ne soit pas la continuité ou la réplique de 1980. C’est la grande différence. Ils observent en revanche des similitudes. A un moment donné, la question linguistique, de l’identité est revenue. Les modes d’organisation, les mots d’ordre ne sont pas les mêmes. Mais le retour aux modes d’organisation des Aârch, Avril 80 n’a pas connu cela.
Y a-t-il une contradiction entre le terme de "Aârch" (et ce qu’il évoque en organisation tribale) et "le mouvement citoyen" qui s’en réclame ?
Bien sûr. Il y a une contradiction. Mais il faut se poser des questions : quelle est la valeur de ce mot en tant que réalité en 2001. Quelle était sa signification au 17e, 18e siècle ? Ce sont des questions essentielles. En 2001, il y a eu des expressions citoyennes quand les jeunes se sont exprimés contre la hogra. Mais comment est-on revenu à une organisation qui se réclame des Aârch, sans fondement à mon avis ? Je ne pense pas qu’en 2001, ceux qui se sont soulevés, ont protesté, s’inscrivent dans l’optique du Aârch au sens original du terme.
Vous écrivez : "Deux éléments m’ont aidé à trouver un fil conducteur des éléments d’analyse. Il s’agit d’abord de la mise en circulation du terme Aârch et de son usage massif par la presse et sa revendication par les acteurs de la contestation." Sa médiatisation en a-t-elle perverti le sens ?
Il y a eu une médiatisation qui m’a semblé un peu abusive du terme de Aârch , une singularisation à la fois du mouvement et de la région qui ne correspond pas à la réalité telle qu’on peut l’observer ou telle que le sociologue ou l’anthropologue peut l’analyser. La réalité est autre. Cet usage, ce mode d’organisation, je les ai observés personnellement. J’ai dit que sur le plan de la gestion de l’urgence, par exemple les comités de village, cela avait effectivement une existence mais l’organisation en terme de Aârch s’est surimposée et à mon avis, a été instrumentalisée.
A ce propos, vous avez employé une expression : "Le commandement collectif". N’a-t-elle pas une connotation péjorative ?
Non. Mais c’était un commandement collectif. Il y avait une instance qui s’était instituée comme commandement collectif de ce mouvement, de type "je ne veux voir qu’une seule tête". C’est la parole de ce commandement qui s’impose, impose ses décisions au détriment de toute autre voix divergente. La liberté des individus a été, à mon avis, limitée par ce mode d’organisation. Cela étant dit, il y a eu des comités de village qui avaient auparavant une existence réelle, comme intervenir, organiser, mais cela ne signifie pas un retour au 17e siècle. Certes, les citoyens ont utilisé le terme, mais je ne pense que, dans leur tête, ce soit un retour au tribalisme. La médiatisation officielle de ce terme a fait penser, effectivement, à ce retour au tribalisme…
Entretien réalisé par Rachid Mokhtari
Bio-express de l'auteur
Mohamed Brahim Salhi est docteur d’Etat es Lettres et Sciences humaines. Il est enseignant-chercheur en sociologie et anthropologie depuis 1979 à l’université de Tizi Ouzou.
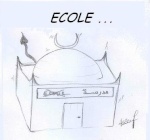
Zhafit- Admin
- Nombre de messages : 13508
Date d'inscription : 26/04/2008
 Re: Mohamed Brahim Salhi : "Le Printemps 80 a contesté le particularisme ethno-religieux de la citoyenneté "
Re: Mohamed Brahim Salhi : "Le Printemps 80 a contesté le particularisme ethno-religieux de la citoyenneté "
http://www.lematindz.net/news/6395-mohamed-brahim-salhi-le-printemps-80-a-conteste-le-particularisme-ethno-religieux-de-la-citoyennete-lire-lentretien.html
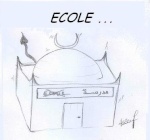
Zhafit- Admin
- Nombre de messages : 13508
Date d'inscription : 26/04/2008
 Sujets similaires
Sujets similaires» Brahim Salhi
» Mohamed Allaoua répond à la raciste et la haineuse Naima Salhi
» Mohamed Aïssa accuse les takfiristes : «46 000 comptes Twitter promeuvent l’extrémisme religieux»
» Aokas : Défrichement contesté
» CELEBRATION DU DOUBLE ANNIVERSAIRE (PRINTEMPS BERB7RE ET PRINTEMPS NOIR)
» Mohamed Allaoua répond à la raciste et la haineuse Naima Salhi
» Mohamed Aïssa accuse les takfiristes : «46 000 comptes Twitter promeuvent l’extrémisme religieux»
» Aokas : Défrichement contesté
» CELEBRATION DU DOUBLE ANNIVERSAIRE (PRINTEMPS BERB7RE ET PRINTEMPS NOIR)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum