Le Village Îvre
Page 1 sur 1
 Le Village Îvre
Le Village Îvre
Le Village Îvre
par Louenas H.
Eh oui ! Il était beau notre village, enfin il l’est encore, il l’est encore quoique… Je me souviens de lui, le village, cet homme beau et insoucieux, allègre et errant, il ne s’est contenté que d’un soupçon de couleurs pour me flanquer mon ébahissement ; les couleurs bondissaient, chatoyantes, dansantes et en froufrou, l’essor frénétique, le feuillage tantôt somnolent tantôt tremblant, il se disloquait de son silence, le silence médicinal…une ivresse, la rosée matinale, le réveil d’une cuite tendre et fougueuse , couleurs jetant, étirant l’arc-en-ciel, l’apothéose, un crépuscule rougissant, attendrissant le firmament…
Mon village semble à première vue n’être que le coin égaré, solitaire dans sa désuétude, reculé, très esseulé, reculé des présences…Mais bof ! Sa façon a lui, apparemment, de se retirer, de prodiguer la clarté, la lumière, pour fredonner son innocence loin des âmes, les âmes forcenées voleuses des évasions.
Il n’a jamais été ingrat, mon village. Maintes fois je l’entendis dire merci…et comment ! Je le lis, enfin je l’entends, dans son silence, silence chantant, silence diseur, silence approbateur, silence preuve de ton émoi… et du mien, de son amour, de son accueil…sans écueils, silence purificateur, habitant la cime de ma gratitude…
Mon village est un accoucheur, l’accoucheur de mes paysages, cérébraux s’entend, tu me léguas tes collines, des collines dardées, fières et orgueilleuses, dénudées, arborées, feuillus ou effeuillées, mais fières quand même, tu me léguas tes arbres, des arbres altiers, altiers et convives, tu me léguas aussi, et surtout, des rivières, des rivières grondantes ou chuchoteuses, mais des poèmes, des chants voyageurs quand même, des maisons nanties et miséreuses, mais toutes fumant une appartenance, un point initiatique commun, d’ailleurs elles sont froides celles frappées du saut de à la page. Tes paysages, tous… Chacun, essayait de mieux me mêler à tes errances imaginatives. Entre eux, ils n’étaient pas haineux mais ils étaient quand même jaloux…Chacun tentait de valoir dans mon cœur le plus grand pesant d’amour. Tes collines criaillant tes brises, tes fontaines glougloutant tes meilleures rigoles, tes rivières en murmures, tes maisons fumant tes feux idylliques, pour que se tapissent derrière les yeux humectés les princes et les princesses, les était une fois « la vache des orphelins »…et tes plaines ! Tes plaines m’étiraient tes nudités et m’accueillaient mes jeux insensés, tes montagnes soufflant, hurlant parfois ton énigme, tes énigmes, ta mer me dessinant tes plus beaux agneaux (Izumar n levher), me caressant, le baiser furtif, cristallin, s’agglutinant à mes nuages vagabondant dans mes rêveries…
Passa un temps, j’ai compris, et nous comprîmes…Chacun de tes paysages, ton identité à toi, tes enfants faisant de leur mieux, mais tes collines étaient les plus envieuses ; elles s’enorgueillissaient, se perchaient dans les terres fertiles, arrogantes, elles dominaient tout, elles surplombaient tellement tout que je me dis que c’est la colline mon identité ; elles y assoyaient les verdures les plus attrayantes, y excellaient des galeries, les galeries florales, s’emparaient des rayons initiateurs des jours heureux. Elles n’avaient pas de secrets, pourtant, les collines. Ce n’était que dominance pour épier.
C’était les rivières, elles, qui, incessantes, murmuraient, disaient en non-dits de doux secrets…je ne comprenais pas leurs secrets. Chaque murmure les enfuyait davantage, les terrait au fin fond de mon incompréhension. Le grondement pour apeurer, le glouglou pour attirer, le serpent des eaux pour errer, pour éluder, dévaster parfois…Chaque manifestation m’éloignait de toi pour me rapprocher. On aurait dit une personne insoucieuse. Elle chuchotait des saisons durant mais hurlait, mégalo, l’hiver. Il n’y avait qu’en été que nous t’intimidions. Parfois, l’été, jetait les crocs de sa démence, sans prévenir, implacable, il lèche les eaux errantes, étouffe leurs murmures. La rivière redevient humble et même nous invitait à ses rares bassines qu’elle put emmitoufler dans une quelque ombre buissonnière, en attendant le passage du démon. Mais, pour nous venger, nous lui préférions la méditerranée. Alors, elle accueillait les sangliers, les chacals, les brebis…Et nous réservait, à son tour, sa haine pour l’hiver.
C’est les fontaines que nous aimions, nous. Les rigoles en manuscrits, les amours interdits Poétesse, elle excelle l’écriture des roses, des roseaux, des arbrisseaux. Gambadant doucereusement, suant sur tous les verges, abreuvant nos bêtes, son eau généreuse cède l’aumône jusqu’au lointain jardin, serpentant dans l’orangeraie, pommeraie, figueraie, oliveraie…se souvenons-nous, nous te baptisâmes village entier, ivre, criard, sourd, tantôt muet, enchanteur, tendre, des fois encoléré, comme tout village, tu as aussi tes pyromanes, des déréglées et fossoyeurs, tes poètes et assassins de fêtes, tes et tes… Le son cristallin quand il se niche dans un souvenir, un village t’habite, hantise tendre qui se voile de silences et de bruits ensorceleurs, le son d’une fontaine ancienne, feuille de figuier ou talus quelconque, dalle aménagée ou échancrure pissant curieusement, fontaine quand même, l’identité quand elle roucoule, une mélodie qui t’emporte toute la vie vers des lieux ou tu puisses puiser dans tes racines, ta fontaine de jouvence.
Grand-mère se souvient toujours des fleurs troublant la flaque de la source, les figues dans la source, le noyer de la source, l’appelle-t-on, vadrouillait de ses racines et s’y abreuvait à longueur d’année, se rajeunit pour que bruisse et valse son manteau, son ombrelle aux mains câlines, et, Le noyer, lui, pour la remercier, accueillait les oiseaux migrateurs, et orchestrait la fontaine de chansons nouvelles, exotiques et nouvelles. Les grappes de raisins se jetaient, convulsives, à ses lèvres humides.
La fontaine aimait surtout les femmes. Elle gardait précieusement leurs secrets. Elle se garder de ne pas les ébruiter. Parce que les femmes ne la rudoyaient pas, la fontaine leur détournait et permettait l’interdit. Elles avaient le droit de s’y faire belles, de s’y barboter…et même d’y accueillir un regard. Un regard d’homme qui, souvent, démarrait les convenances. En échange de cette connivence, les femmes assuraient à la fontaine des présences. Une fontaine désertée est une maison sans enfants. Alors, vivement les femmes, vivement les regards pour peupler la fontaine. L’amphore ne cessera pas ces virées à la fontaine. Se rivaliseront les toilettes, se jalouseront les cœurs, chatoieront les cheveux, froufrouteront les robes, se divulgueront les secrets…Parfois, des femmes y revenaient des dizaines de fois, même dans l’exagération, elles auraient préféré que la fontaine ne cèderait son eau qu’en pleurant…Bien sur, pour y rester plus longtemps et guetter le surgissement. Mais, il faut faire attention. Le sobriquet : « Aicha N’Tala », Aicha de la fontaine, guette les irrévérencieuses. Même vieilles, le sobriquet ne les quittera plus.
Autrefois, la fontaine de la source, un été durant, cessa de parler son eau. La fontaine au début consola les plaies causées par les crocs infernaux d’un soleil haineux. Jamais l’été n’avait eu autant soif. Il lapa, sans compassion, jusqu’aux eaux exilées dans les cavités, jusqu’aux humidités tapies dans le labyrinthe des racines. Le noyer fit de son mieux pour étirer son parapluie et ombrer la fontaine des rais envieux. L’eau devint la denrée rare qu’on se devait de partager minutieusement. Mais, les hommes, au lieu de remercier sa grâce, discutèrent haineusement son sort, se bagarrèrent et se saignèrent. Le sang pollua l’argent pur de la source. La fontaine glouglouta pour pleurer d’affligeantes larmes et ne tarda pas à opter pour le mutisme.
Se délesta de son sourire La source pleura solitaire Le glouglou en souvenir Autrefois la douceur de vivre.
Les couleurs descendirent des feuillages, la verdure déserta les vergers, les figues, les raisins, les grenades, les melons se suicidèrent, les chants s’égosillèrent, les senteurs puèrent et les hommes accostèrent très loin, dans un autre village et eurent tout leur temps pour se morfondre, se morigéner et se rappeler cet autrefois des temps heureux et des jours insouciants. Heureusement, l’hiver venant, il rugit, meugla et hurla, se lamenta, pleura et souffla, soupira, fit danser le ciel, valser les arbres, quémanda et implora le pardon, il larmoya des cordes et cordons, il accoucha des flocons et des hurlements, il enjôla la source de ses pluies les plus fines, y glissa des vies et chansons, jusque dans son sein affecté par les crocs O combien profonds de l’austérité.
La fontaine, émue, se souvint et se rappela, puis apitoyée, elle se rappela la colline dénudée, l’olivier sénile, le figuier échevelé, la plaine épilée de ses marguerites, le laurier décapité de son diadème…elle pleura le premier sanglot, ensuite le deuxième, et puis le troisième…Elle parla enfin, glouglouta, puis coula raisonneuse, jeta ses serpents errants peu après et promit de toujours dire.
Les hommes revinrent, immolèrent un bœuf géant, aux cornes spiralées et aux yeux saillants, des enfants virevoltèrent et bourdonnèrent comme un essaim d’abeilles joyeuses, les femmes youyoutèrent et firent cliqueter leurs bijoux, les amphores aux aguets, elles foisonnèrent, guindées et fières, fardées et bigarrées, elles se ruèrent sur la fontaine… et s’excusèrent. Juste un temps, et poussèrent en argile brune des maisons, vêtues de tuiles pour attendrir la colère du ciel et fumèrent, désormais, le bien être et l’insouciance.
Nous pûmes ainsi grandir, assistés de glouglous, de murmures, de douceurs, de clapotements…Nous devînmes, tous, sans le savoir, des poètes…
Je me souviens de ce photographe que tous les confrères jalousaient, lui…Il écrivait des poèmes en photos, il pouvait passer des jours et des nuits à guetter un coucher de soleil, une étreinte de vagues, un nuage en or. Les autres ne savaient pas que c’était parce qu’il était poète Et cet handicapé, amoureux à chaque yeux verts. La seule femme qui l’embrassa avait les yeux verts. N’était-ce pas un poète, un grand poète ? Il n’a jamais arrêté de renouveler son premier amour et peut être le dernier. Il n’a jamais cessé de voler… et nous qui ne volons pas malgré notre entièreté…C’est nous qui sommes, donc, les vrais handicapés.
Le menuisier qui dessinait pour nous des meubles pour y taire nos intimités, le maçon qui fabulait la brique pour que nous habitions le rêve, le peupler et l’engrosser, le paysan qui dessinait de merveilleux sillons…Tous des poètes, chacun à sa manière…
Nous étions tellement ivres ! Non, il était vraiment ivre notre village.
source: http://www.kabyles.net/Le-Village-Ivre.html
par Louenas H.
Eh oui ! Il était beau notre village, enfin il l’est encore, il l’est encore quoique… Je me souviens de lui, le village, cet homme beau et insoucieux, allègre et errant, il ne s’est contenté que d’un soupçon de couleurs pour me flanquer mon ébahissement ; les couleurs bondissaient, chatoyantes, dansantes et en froufrou, l’essor frénétique, le feuillage tantôt somnolent tantôt tremblant, il se disloquait de son silence, le silence médicinal…une ivresse, la rosée matinale, le réveil d’une cuite tendre et fougueuse , couleurs jetant, étirant l’arc-en-ciel, l’apothéose, un crépuscule rougissant, attendrissant le firmament…
Mon village semble à première vue n’être que le coin égaré, solitaire dans sa désuétude, reculé, très esseulé, reculé des présences…Mais bof ! Sa façon a lui, apparemment, de se retirer, de prodiguer la clarté, la lumière, pour fredonner son innocence loin des âmes, les âmes forcenées voleuses des évasions.
Il n’a jamais été ingrat, mon village. Maintes fois je l’entendis dire merci…et comment ! Je le lis, enfin je l’entends, dans son silence, silence chantant, silence diseur, silence approbateur, silence preuve de ton émoi… et du mien, de son amour, de son accueil…sans écueils, silence purificateur, habitant la cime de ma gratitude…
Mon village est un accoucheur, l’accoucheur de mes paysages, cérébraux s’entend, tu me léguas tes collines, des collines dardées, fières et orgueilleuses, dénudées, arborées, feuillus ou effeuillées, mais fières quand même, tu me léguas tes arbres, des arbres altiers, altiers et convives, tu me léguas aussi, et surtout, des rivières, des rivières grondantes ou chuchoteuses, mais des poèmes, des chants voyageurs quand même, des maisons nanties et miséreuses, mais toutes fumant une appartenance, un point initiatique commun, d’ailleurs elles sont froides celles frappées du saut de à la page. Tes paysages, tous… Chacun, essayait de mieux me mêler à tes errances imaginatives. Entre eux, ils n’étaient pas haineux mais ils étaient quand même jaloux…Chacun tentait de valoir dans mon cœur le plus grand pesant d’amour. Tes collines criaillant tes brises, tes fontaines glougloutant tes meilleures rigoles, tes rivières en murmures, tes maisons fumant tes feux idylliques, pour que se tapissent derrière les yeux humectés les princes et les princesses, les était une fois « la vache des orphelins »…et tes plaines ! Tes plaines m’étiraient tes nudités et m’accueillaient mes jeux insensés, tes montagnes soufflant, hurlant parfois ton énigme, tes énigmes, ta mer me dessinant tes plus beaux agneaux (Izumar n levher), me caressant, le baiser furtif, cristallin, s’agglutinant à mes nuages vagabondant dans mes rêveries…
Passa un temps, j’ai compris, et nous comprîmes…Chacun de tes paysages, ton identité à toi, tes enfants faisant de leur mieux, mais tes collines étaient les plus envieuses ; elles s’enorgueillissaient, se perchaient dans les terres fertiles, arrogantes, elles dominaient tout, elles surplombaient tellement tout que je me dis que c’est la colline mon identité ; elles y assoyaient les verdures les plus attrayantes, y excellaient des galeries, les galeries florales, s’emparaient des rayons initiateurs des jours heureux. Elles n’avaient pas de secrets, pourtant, les collines. Ce n’était que dominance pour épier.
C’était les rivières, elles, qui, incessantes, murmuraient, disaient en non-dits de doux secrets…je ne comprenais pas leurs secrets. Chaque murmure les enfuyait davantage, les terrait au fin fond de mon incompréhension. Le grondement pour apeurer, le glouglou pour attirer, le serpent des eaux pour errer, pour éluder, dévaster parfois…Chaque manifestation m’éloignait de toi pour me rapprocher. On aurait dit une personne insoucieuse. Elle chuchotait des saisons durant mais hurlait, mégalo, l’hiver. Il n’y avait qu’en été que nous t’intimidions. Parfois, l’été, jetait les crocs de sa démence, sans prévenir, implacable, il lèche les eaux errantes, étouffe leurs murmures. La rivière redevient humble et même nous invitait à ses rares bassines qu’elle put emmitoufler dans une quelque ombre buissonnière, en attendant le passage du démon. Mais, pour nous venger, nous lui préférions la méditerranée. Alors, elle accueillait les sangliers, les chacals, les brebis…Et nous réservait, à son tour, sa haine pour l’hiver.
C’est les fontaines que nous aimions, nous. Les rigoles en manuscrits, les amours interdits Poétesse, elle excelle l’écriture des roses, des roseaux, des arbrisseaux. Gambadant doucereusement, suant sur tous les verges, abreuvant nos bêtes, son eau généreuse cède l’aumône jusqu’au lointain jardin, serpentant dans l’orangeraie, pommeraie, figueraie, oliveraie…se souvenons-nous, nous te baptisâmes village entier, ivre, criard, sourd, tantôt muet, enchanteur, tendre, des fois encoléré, comme tout village, tu as aussi tes pyromanes, des déréglées et fossoyeurs, tes poètes et assassins de fêtes, tes et tes… Le son cristallin quand il se niche dans un souvenir, un village t’habite, hantise tendre qui se voile de silences et de bruits ensorceleurs, le son d’une fontaine ancienne, feuille de figuier ou talus quelconque, dalle aménagée ou échancrure pissant curieusement, fontaine quand même, l’identité quand elle roucoule, une mélodie qui t’emporte toute la vie vers des lieux ou tu puisses puiser dans tes racines, ta fontaine de jouvence.
Grand-mère se souvient toujours des fleurs troublant la flaque de la source, les figues dans la source, le noyer de la source, l’appelle-t-on, vadrouillait de ses racines et s’y abreuvait à longueur d’année, se rajeunit pour que bruisse et valse son manteau, son ombrelle aux mains câlines, et, Le noyer, lui, pour la remercier, accueillait les oiseaux migrateurs, et orchestrait la fontaine de chansons nouvelles, exotiques et nouvelles. Les grappes de raisins se jetaient, convulsives, à ses lèvres humides.
La fontaine aimait surtout les femmes. Elle gardait précieusement leurs secrets. Elle se garder de ne pas les ébruiter. Parce que les femmes ne la rudoyaient pas, la fontaine leur détournait et permettait l’interdit. Elles avaient le droit de s’y faire belles, de s’y barboter…et même d’y accueillir un regard. Un regard d’homme qui, souvent, démarrait les convenances. En échange de cette connivence, les femmes assuraient à la fontaine des présences. Une fontaine désertée est une maison sans enfants. Alors, vivement les femmes, vivement les regards pour peupler la fontaine. L’amphore ne cessera pas ces virées à la fontaine. Se rivaliseront les toilettes, se jalouseront les cœurs, chatoieront les cheveux, froufrouteront les robes, se divulgueront les secrets…Parfois, des femmes y revenaient des dizaines de fois, même dans l’exagération, elles auraient préféré que la fontaine ne cèderait son eau qu’en pleurant…Bien sur, pour y rester plus longtemps et guetter le surgissement. Mais, il faut faire attention. Le sobriquet : « Aicha N’Tala », Aicha de la fontaine, guette les irrévérencieuses. Même vieilles, le sobriquet ne les quittera plus.
Autrefois, la fontaine de la source, un été durant, cessa de parler son eau. La fontaine au début consola les plaies causées par les crocs infernaux d’un soleil haineux. Jamais l’été n’avait eu autant soif. Il lapa, sans compassion, jusqu’aux eaux exilées dans les cavités, jusqu’aux humidités tapies dans le labyrinthe des racines. Le noyer fit de son mieux pour étirer son parapluie et ombrer la fontaine des rais envieux. L’eau devint la denrée rare qu’on se devait de partager minutieusement. Mais, les hommes, au lieu de remercier sa grâce, discutèrent haineusement son sort, se bagarrèrent et se saignèrent. Le sang pollua l’argent pur de la source. La fontaine glouglouta pour pleurer d’affligeantes larmes et ne tarda pas à opter pour le mutisme.
Se délesta de son sourire La source pleura solitaire Le glouglou en souvenir Autrefois la douceur de vivre.
Les couleurs descendirent des feuillages, la verdure déserta les vergers, les figues, les raisins, les grenades, les melons se suicidèrent, les chants s’égosillèrent, les senteurs puèrent et les hommes accostèrent très loin, dans un autre village et eurent tout leur temps pour se morfondre, se morigéner et se rappeler cet autrefois des temps heureux et des jours insouciants. Heureusement, l’hiver venant, il rugit, meugla et hurla, se lamenta, pleura et souffla, soupira, fit danser le ciel, valser les arbres, quémanda et implora le pardon, il larmoya des cordes et cordons, il accoucha des flocons et des hurlements, il enjôla la source de ses pluies les plus fines, y glissa des vies et chansons, jusque dans son sein affecté par les crocs O combien profonds de l’austérité.
La fontaine, émue, se souvint et se rappela, puis apitoyée, elle se rappela la colline dénudée, l’olivier sénile, le figuier échevelé, la plaine épilée de ses marguerites, le laurier décapité de son diadème…elle pleura le premier sanglot, ensuite le deuxième, et puis le troisième…Elle parla enfin, glouglouta, puis coula raisonneuse, jeta ses serpents errants peu après et promit de toujours dire.
Les hommes revinrent, immolèrent un bœuf géant, aux cornes spiralées et aux yeux saillants, des enfants virevoltèrent et bourdonnèrent comme un essaim d’abeilles joyeuses, les femmes youyoutèrent et firent cliqueter leurs bijoux, les amphores aux aguets, elles foisonnèrent, guindées et fières, fardées et bigarrées, elles se ruèrent sur la fontaine… et s’excusèrent. Juste un temps, et poussèrent en argile brune des maisons, vêtues de tuiles pour attendrir la colère du ciel et fumèrent, désormais, le bien être et l’insouciance.
Nous pûmes ainsi grandir, assistés de glouglous, de murmures, de douceurs, de clapotements…Nous devînmes, tous, sans le savoir, des poètes…
Je me souviens de ce photographe que tous les confrères jalousaient, lui…Il écrivait des poèmes en photos, il pouvait passer des jours et des nuits à guetter un coucher de soleil, une étreinte de vagues, un nuage en or. Les autres ne savaient pas que c’était parce qu’il était poète Et cet handicapé, amoureux à chaque yeux verts. La seule femme qui l’embrassa avait les yeux verts. N’était-ce pas un poète, un grand poète ? Il n’a jamais arrêté de renouveler son premier amour et peut être le dernier. Il n’a jamais cessé de voler… et nous qui ne volons pas malgré notre entièreté…C’est nous qui sommes, donc, les vrais handicapés.
Le menuisier qui dessinait pour nous des meubles pour y taire nos intimités, le maçon qui fabulait la brique pour que nous habitions le rêve, le peupler et l’engrosser, le paysan qui dessinait de merveilleux sillons…Tous des poètes, chacun à sa manière…
Nous étions tellement ivres ! Non, il était vraiment ivre notre village.
source: http://www.kabyles.net/Le-Village-Ivre.html
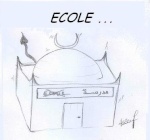
Zhafit- Admin
- Nombre de messages : 13508
Date d'inscription : 26/04/2008
 Sujets similaires
Sujets similaires» « Hadjar djana Khabet, Hadjar djana Khabet… (Hadjar était ivre, Hadjar était ivre…)
» Le village Ikherchouchen(à Amalou) village natal de Abderrahmane Farès
» Inauguration de la stèle de Jean Amrouche à IghiL ALI
» LA FONTAINE DU VILLAGE
» Village n'Ath-Mraou
» Le village Ikherchouchen(à Amalou) village natal de Abderrahmane Farès
» Inauguration de la stèle de Jean Amrouche à IghiL ALI
» LA FONTAINE DU VILLAGE
» Village n'Ath-Mraou
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum